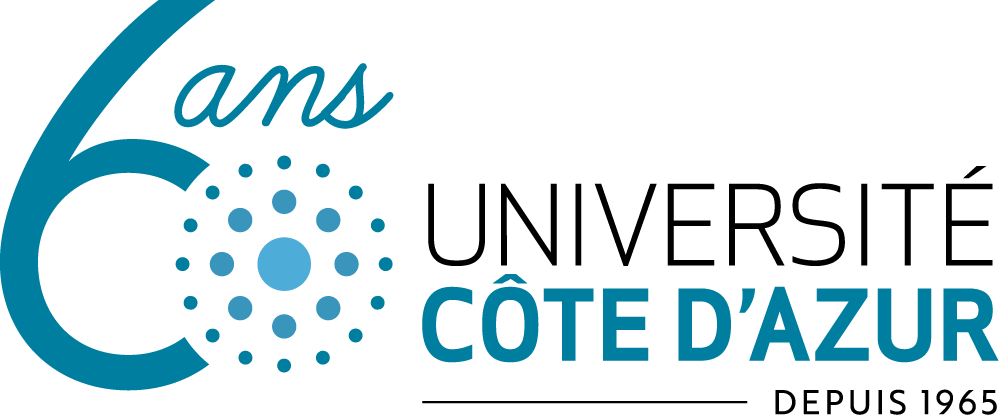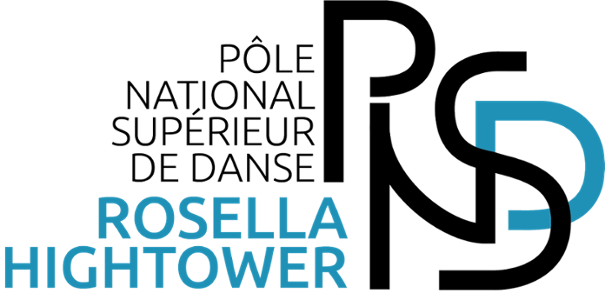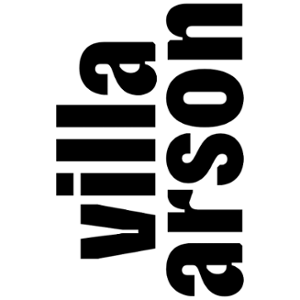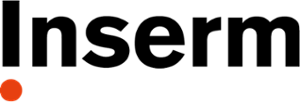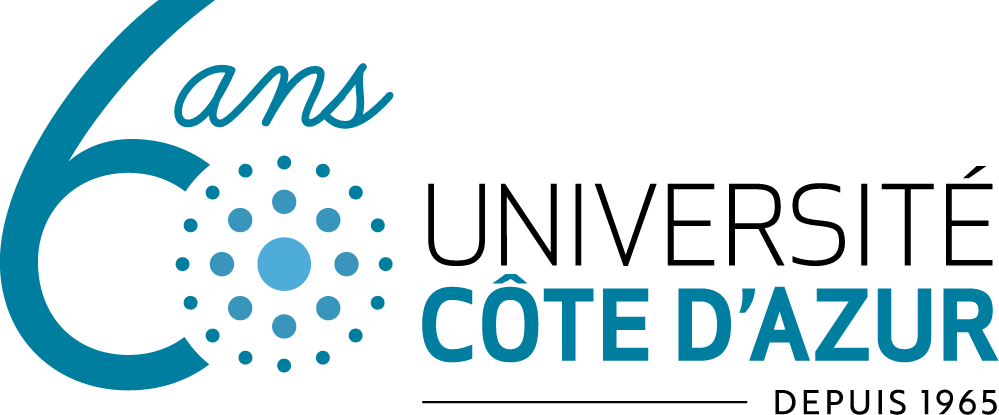« On sort complètement de la gamme des périodes douces que l’humanité sédentaire a connues pendant des centaines de milliers d’années »
- Recherche
le 23 novembre 2018

Entretien avec Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherches au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (CEA) et co-présidente du chapitre paléoclimat du 4ème rapport du GIEC
Le Campus Universitaire St Jean d’Angély a accueilli du 29 octobre au 2 novembre dernier les Assises de la Transition Écologique et Citoyenne Alpes-Maritimes Alpes du Sud. Cet événement a été notamment marqué par la présence de Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherches au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (CEA) et co-présidente du chapitre paléoclimat du 4ème rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 1988). Le document, largement médiatisé, appelle à une forte mobilisation internationale pour ne pas dépasser 1,5 degrés d’augmentation des températures par rapport à l’ère pré-industrielle d’ici à 2030.
La température moyenne à la surface du globe a augmenté de 1°C depuis 1880. Quand a-t-on commencé à s’alerter des conséquences de l’industrialisation sur le climat ? Quels ont été les premiers signaux d’alerte ayant amené les scientifiques à s’interroger et à tenter d’établir des modèles ?
VMD : Le sciences du climat modernes sont nées surtout à partir des années 1950. Les réseaux d’observation ont été établis avant, mais plutôt pour les prévisions météo et pas forcément pour avoir un enregistrement à l’échelle de plusieurs décennies. En France, les réseaux de mesure ont commencé à être mis en place à la fin du 18e siècle. Au niveau mondial, plutôt au milieu du 19e siècle. Ces observations montraient une variabilité, une tendance au réchauffement, qu’on a commencée à voir dans les années 1960.
À l’époque, quelles données intéressaient les scientifiques ?
VMD : Les températures à la surface des continents et des mers. En parallèle, la science physique a joué un rôle fondamental. Les premières idées sur le fonctionnement de l’atmosphère, le fait qu’elle laisse passer les rayons solaires et en réfléchisse une partie, qu’elle contienne des composés présents en toute petite quantité mais avec la capacité de maintenir une certaine quantité de chaleur sur la Terre en l’empêchant de partir vers l’espace, tout cela vient de la physique de Joseph Fourrier et d’autres, ailleurs qu’en France, au début du 20e siècle. C’est à ce moment là qu’on commence à décrire l’effet de serre. Dans les années 60, vient ensuite une compréhension plus fine de la composition de l’atmosphère. On a par exemple les premières mesures de dioxyde de carbone dans l’air et on commence à faire le lien entre l’augmentation des taux et les activités humaines. Par la suite, on élabore les premiers modèles de climats, au sens où on met en équation le fonctionnement de l’atmosphère, ses interactions avec la surface agglutinante des océans, le rôle des zones glacées etc. Tout cela s’est affiné au cours du temps, avec des outils de plus en plus performants, sans oublier les observations depuis l’espace au moyen des satellites. Dans les années 80, les observations faites sur les calottes de glace ont montré à quel point l’augmentation très rapide de la concentration en gaz à effet de serre de l’atmosphère n’était pas quelque chose de banal, mais vraiment une rupture, sans précédent depuis 800 000 ans.
Les progrès dans les techniques d’extraction et d’analyse des résidus très anciens de la végétation, de la composition de l’air, des sols, de la faune, ont dû considérablement faire avancer la recherche ? Aujourd’hui, sur une zone géographique donnée, sommes-nous en mesure de reconstituer en continu l’évolution du climat ?
VMD : Pas forcément sur de petites zones, car cela va dépendre des archives naturelles à disposition, mais je dirais que chacune d’elles est une pièce de puzzle. On a une bonne connaissance, par exemple, de la variation des températures pour l’ensemble des bassins océaniques et des continents depuis 2000 ans. Plus on s’éloigne dans le temps plus on a des incertitudes sur les éléments qu’on enregistre et on a parfois aussi moins de diversité d’informations.
Vous nous avez présenté l’impact de l’homme dont on parle aujourd’hui comme étant sans précédent. Néanmoins, dans le passé, la révolution agraire a-t-elle eu une incidence sur le climat local ou global ?
VMD : Elle a affecté profondément la biodiversité, les forêts, le climat régional. Mais dans l’état des connaissances telles qu’elles sont établies par l’ensemble de la communauté scientifique, l’effet sur le climat global a été probablement très réduit. Même si en Asie, en Europe, depuis plusieurs milliers d’années, il y a des transformations des paysages par l’activité agricole (riziculture, déforestation et mise en place de cultures), l’effet sur le climat à l’échelle planétaire date vraiment de la révolution industrielle, à partir de 1750 avec d’abord les machines à vapeur. S’est ajoutée ensuite une déforestation accélérée, par des techniques puissantes, à grande échelle, plus l’exploitation du charbon, du gaz et du pétrole.
Les modèles et les simulations d’évolution du climat sont-ils « testés » sur ce qu’on connait, c’est-à-dire sur le passé et le présent, pour être validés ? Est-ce qu’on utilise par exemple des données anciennes pour voir si on arrive bien à décrire des phénomènes climatiques présents ?
VMD : Les modèles sont testés en permanence, sur la prévision météorologique, mais aussi sur leur capacité à représenter les processus et à simuler les tendances depuis 150 ans. Ils sont évalués sur leur capacité effectivement à représenter les changements passés et ce sur des périodes très contrastées, par exemple très chaudes ou glaciaires. On essaie ainsi de couvrir les variations des derniers millénaires. Il existe des exercices internationaux, dans lesquels les équipes qui développent des modèles de climat vont faire des simulations standardisées, un peu comme au patinage artistique il y a des figures imposées, et ensuite on va confronter les résultats des modèles aux observations. On sait ainsi qu’on est bons sur les gros changements de température.
En tant que paléoclimatologue, cela me donne vraiment confiance sur notre compréhension de l’énergétique du sytème climatique, c’est à dire sur la manière dont le climat va réagir à une perturbation donnée. Or l’enjeu est là, dans la compréhension des phénomènes amplificateurs ou stabilisateurs. C’est surtout important parce qu’on va vers une perturbation forte. On est déjà à un degré d’augmentation des températures par rapport au climat pré-industriel. D’ici à une vingtaine d’années on peut être à 1,5 degrés. Si on ne change rien, au milieu du siècle on sera à 2 degrés. C’est-à-dire qu’on sort complètement de la gamme des périodes douces que l’humanité sédentaire a connues pendant des centaines de milliers d’années.
Un changement plus grand nous précipiterait vraiment vers un autre monde. Utiliser des climats chauds à l’échelle géologique ancienne est intéressant pour se faire une idée de ce qu’on pourrait connaître d’ici à 50 ou 100 ans. Par exemple, la dernière fois qu’il y a eu 400 ppm de CO2 dans l’atmosphère (comme aujourd’hui), c’était au Miocène, il y a plus de 3 millions d’années. Le climat était 2 à 4 degrés plus chaud que le climat préindustriel. Le niveau des mers était 10 à 20 mètres plus élevé et ça s’est produit sur plusieurs dizaines de milliers d’années.
Les scénarios présentés dans le rapport du GIEC que vous avez co-présidé présentent-ils des simulations sur le court ou le long terme ? Intègrent-ils les politiques nationales, les orientations économiques (par exemple le passage aux véhicules électriques, le développement d’une économie circulaire), les comportements citoyens ?
VMD : Sur le 1,5 degrés, nous avons répondu à une demande de la COP 21 de les renseigner sur notre capacité à stabiliser le changement. Mais dans les travaux de recherche qui alimentent les rapports du GIEC, on explore un ensemble de scénarios possibles, très axés sur le développement durable, moins consommateur de ressources, qui rejette moins de gaz à effet de serre, ou à l’opposé des scénarios très intensifs en énergie fossile, qui donnent un réchauffement très fort. On explore une gamme qui va d’une stabilisation à 1,5 degrés, à un réchauffement qui pourrait dépasser 4 degrés d’ici à la fin de ce siècle, puis typiquement 8 degrés sur deux siècles. Chaque scénario explore différents choix de développement, qui dépendront de l’évolution démographique, de l’urbanisation, de la consommation, de grands systèmes : énergétiques, alimentaires et agricoles, industriels, et aussi du fonctionnement du système financier. Notre certitude est que si on veut vraiment stabiliser le changement à 1,5 degrés, il faut agir tout de suite et le plus fort possible. Pour cela, on est obligé d’actionner tous les leviers, en fonction du degré de développement de chaque pays et des ressource locales disponibles.
On entend parfois dire que l’investissement dans les énergies renouvelables, compte-tenu du processus de fabrication des panneaux solaires et des éoliennes, au regard des rendements, serait « une fausse bonne idée ». Qu’en est-il ?
VMD : Dans le rapport, les experts sur les transitions disent qu’on assiste actuellement à une rupture disruptive pour la production d’électricité renouvelable et le stockage d’énergie. Ils le voient à travers la capacité de production et les progrès sur les baisses de prix des productions éoliennes et photovoltaïques dans le monde d’une part et d’autre part en raison des progrès réguliers réalisés sur les matériaux des batteries. Ils soulignent qu’il manque des ruptures de cette nature dans d’autres secteurs comme le bâtiment et les transports. Or là, du point de vue du développement des technologies, on ne voit rien d’encore aussi mûre et performant. En France, on n’a pas fait le choix de développer des filières industrielles dans ces secteurs donc on est assez en retrait par rapport à des choses qui se produisent en Asie et en Amérique du Nord essentiellement, mais aussi au Danemark pour l’éolien de puissance, en Espagne sur le photovoltaïque. Comme on ne crée pas d’emploi ou de valeur autour de ces choses on ne se rend pas compte de cette transition chez nous.
Il ne suffit pas de réduire les émissions de gaz à effets de serre mais également de savoir quoi faire de ceux déjà émis. Quelle proportion actuellement ne peut pas être re-capturée naturellement par la végétation ou les océans ?
VMD : Ça va vraiment dépendre des gaz. Certains, comme le méthane, ont une durée de vie dans l’atmosphère relativement courte. Il a un effet très puissant, mais au bout de 10 à 20 ans il disparaît de l’atmosphère par réaction chimique. Ensuite, on a l’oxyde nitreux, à longue durée de vie, émis en particulier par les activités qui utilisent des engrais azotés. Enfin, celui qui a le plus d’effet sur le climat, c’est le dioxyde de carbone. Sur ce qu’on émet chaque année, soit 42 milliards de tonnes, il y en a à peu près la moitié qui es reprise par les océans (en créant de l’acidification), la végétation, les sols. Ces « moitiés » s’ajoutent les unes aux autres chaque année. Les processus naturels de re-capture sont très lents (l’altération des roches, par exemple). Ainsi, environ 20% de ce qui est dans l’atmosphère aujourd’hui y restera pour une durée de l’ordre de mille ans si on n’est pas capable d’intervenir pour l’enlever et de le stocker de manière durable.
Quelles sont les pistes les plus prometteuses pour venir soutenir les phénomènes naturels saturés ?
VMD : En premier lieu, éviter de mettre les gaz dans l’atmosphère, puis restaurer des écosystèmes qui jouent ce rôle de puits de carbone. Il s’agit de réimplanter des forêts primaires, surtout dans les régions tropicales où la productivité de la végétation est élevée, d’entretenir des écosystèmes côtiers comme les tourbières, de protéger les milieux marins côtiers, de promouvoir certaines pratiques agricoles qui vont favoriser la capture du CO2 par les sols. Il existe également des pistes du côté des matériaux de construction. Certains ciments pourraient ainsi extraire du CO2 de l’atmosphère au lieu d’en rejeter, comme c’est le cas actuellement. On évoque enfin des choses potentiellement beaucoup plus risquées, comme le développement de centrales de production de chaleur ou d’électricité à partir de la biomasse (de la matière première organique). Cette piste risquerait de voir se développer des cultures à grande échelle dédiées à la biomasse pour les filières énergétiques. Cette dernière option pause donc le risque d’accaparement de terre, de pression sur la sécurité alimentaire et sur la biodiversité. On voit très bien ce qui arrive avec les agro-carburants ou l’huile de palme. D’autres options technologiques sont également explorées pour, directement, par des méthodes physico-chimiques, pomper l’air, le filtrer, extraire le CO2 et le stocker sous forme minérale ou autre. Il existe des prototypes, mais associés à un coût. Finalement, le développement de ces différentes options va être conditionné à un encadrement politique très fort. Il va falloir donner un prix aux gaz à effet de serre pour créer des débouchés dédiés à l’extraction du CO2. Ça ne pourra pas se faire spontanément.